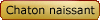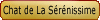Patrimoine. La fin de Venise
Article paru dans l'ÃĐdition du Monde le 19.10.91
L'Etat italien, plongÃĐ dans ses problÃĻmes de dÃĐficits publics, a dÃĐcidÃĐ d'interrompre l'aide qu'il devait consacrer au sauvetage de la CitÃĐ des doges. Cette dÃĐcision, rendue publique il y a quelques jours, alimente une vive polÃĐmique sur le sort de la ville.
VENISE comptait au dix-huitiÃĻme siÃĻcle deux cent mille habitants, dont cent mille foresti, c'est-à -dire, en dialecte, des " non-VÃĐnitiens ", ÃĐtrangers à la ville (et, pour un VÃĐnitien, un Romain ou un Napolitain tendaient à Être plus foresti encore qu'un Parisien). Elle ÃĐtait alors une ville cosmopolite, pluriethnique et transnationale. Et elle ÃĐtait encore l'une des citÃĐs les plus riches du monde.
Dans son dernier livre sur Venise, qui est presque un testament spirituel, sa vision du rapport passÃĐ-prÃĐsent (Venezia, Immagine di une città , Bologne, Il Mulino, 1984,
 tographies de Folco Quilici ; ÃĐdition française Arthaud, 1985), Fernand Braudel dÃĐfinissait le Settecento vÃĐnitien comme une pÃĐriode " prodigieuse ". La SÃĐrÃĐnissime, bien sÃŧr, ÃĐtait alors dans une phase de dÃĐclin, en tant qu'empire mÃĐditerranÃĐen et puissance europÃĐenne. Mais, à l'opposÃĐ de ce dÃĐclin, elle atteignait les sommets europÃĐens en matiÃĻre de culture littÃĐraire, thÃĐÃĒtrale et musicale, sans parler des arts figuratifs. Dans le mÊme temps, elle bÃĒtissait ces remparts contre la mer, les murazzi, qui, dignes selon Braudel des oeuvres architecturales des anciens Romains, l'ont protÃĐgÃĐe de l'Adriatique jusqu'à nos jours. Au cours du dix-huitiÃĻme siÃĻcle, Venise donnait un nouveau cours à son destin de capitale cosmopolite : capitale universelle, non plus d'un empire transnational, mais de la culture et des arts.
tographies de Folco Quilici ; ÃĐdition française Arthaud, 1985), Fernand Braudel dÃĐfinissait le Settecento vÃĐnitien comme une pÃĐriode " prodigieuse ". La SÃĐrÃĐnissime, bien sÃŧr, ÃĐtait alors dans une phase de dÃĐclin, en tant qu'empire mÃĐditerranÃĐen et puissance europÃĐenne. Mais, à l'opposÃĐ de ce dÃĐclin, elle atteignait les sommets europÃĐens en matiÃĻre de culture littÃĐraire, thÃĐÃĒtrale et musicale, sans parler des arts figuratifs. Dans le mÊme temps, elle bÃĒtissait ces remparts contre la mer, les murazzi, qui, dignes selon Braudel des oeuvres architecturales des anciens Romains, l'ont protÃĐgÃĐe de l'Adriatique jusqu'à nos jours. Au cours du dix-huitiÃĻme siÃĻcle, Venise donnait un nouveau cours à son destin de capitale cosmopolite : capitale universelle, non plus d'un empire transnational, mais de la culture et des arts.
C'est l'Europe des nationalismes naissants, bientÃīt exaltÃĐs par la RÃĐvolution française, qui a brisÃĐ ce destin international de Venise en mettant fin à sa tradition millÃĐnaire de libertÃĐ et d'indÃĐpendance. En 1797, pour la premiÃĻre fois de son histoire, la ville fut brutalement mise à sac par les sans-culottes du gÃĐnÃĐral Baraguay d'Hilliers. Elle fut ensuite dominÃĐe par les Autrichiens, puis à nouveau par les Français, avant de repasser, jusqu'en 1866, sous contrÃīle autrichien, et enfin, aprÃĻs cette date, sous domination italienne. Deux siÃĻcles durant, Venise a dÃŧ se dÃĐfendre dÃĐsespÃĐrÃĐment contre le phÃĐnomÃĻne que les historiens dÃĐsignent sous le terme d'" homologation " : on a voulu l'assimiler à des institutions et à des rÃĻgles constitutionnelles qui lui ÃĐtaient ÃĐtrangÃĻres, la rattacher, alors qu'elle avait toujours ÃĐtÃĐ une ÃŪle, à la terre ferme, l'adapter à l'industrie pÃĐtroliÃĻre, et, plus gÃĐnÃĐralement, aux formes successives de la modernitÃĐ. Chacune des administrations qui ont tour à tour ÃĐtendu leur empire sur la lagune a tentÃĐ de normaliser Venise, c'est-à -dire d'en faire une ville comme les autres. Se sont ainsi succÃĐdÃĐ, selon la dÃĐfinition donnÃĐe par l'historien vÃĐnitien Giannantonio Paladini, un " dix-neuviÃĻme siÃĻcle de l'ÃĐventrement " urbain (1) et un " vingtiÃĻme siÃĻcle du comblement " de la lagune (2), visant à ne plus faire qu'un de la ville et de la terre ferme.
Le rÃīle de la culture française
Alors mÊme que plusieurs Etats europÃĐens cherchaient ainsi à assimiler Venise, l'Europe culturelle commençait à entretenir le mythe d'une " Venise à sauver " : à bien y regarder, ce courant devait prÃĐcisÃĐment son origine à la mauvaise conscience que nourrissait l'Europe face à la plus ancienne et la plus civique des rÃĐpubliques de son histoire chrÃĐtienne. Dans l'ÃĐlaboration de ce mythe, qui eut des moments sublimes, la culture française a jusqu'à nos jours tenu le premier rÃīle, presque au point de gommer de son subconscient le pillage de Bonaparte et les ÃĐventrements de NapolÃĐon. Dans le mÊme temps, Venise, qui ÃĐtait dÃĐjà trÃĻs liÃĐe à la France (Goldoni et Casanova ÃĐcrivaient en français), a instaurÃĐ de son cÃītÃĐ, à partir de 1797, une relation privilÃĐgiÃĐe, complexe, ambiguÃŦ et d'une certaine maniÃĻre freudienne, avec cette nation qui, la premiÃĻre, avait violÃĐ l'indÃĐpendance et la libertÃĐ de la ville. Ce rapport privilÃĐgiÃĐ avec la France est encore vif de nos jours dans la conscience des derniers VÃĐnitiens.
Les VÃĐnitiens, qui ÃĐtaient encore 176 000 en 1951, ne sont plus aujourd'hui que 77 000, et leur moyenne d'ÃĒge est la plus ÃĐlevÃĐe de toute l'Italie. Au cours de cet exode biblique, ce sont les composantes les plus actives, dynamiques et vivaces de la population qui ont fui Venise. Dans son bel ouvrage Fondamenta degli incurabili (Milan, Adelphi 1991), le Prix Nobel Joseph Brodsky a dÃĐfini ce qui survit aujourd'hui de l'humanitÃĐ vÃĐnitienne comme un " village tribal " : en s'implifiant à grands traits, les VÃĐnitiens contemporains ne sont plus en mesure de protÃĐger la ville et la lagune des assauts de la modernitÃĐ, reprÃĐsentÃĐs par l'Italie et surtout par la VÃĐnÃĐtie de la terre ferme.
AndrÃĐ Chastel, grand connaisseur de la ville, ami français de Venise et presque VÃĐnitien d'adoption, l'ÃĐcrivait dans les colonnes du Monde des 14 et 15 dÃĐcembre 1969 : " Venise est devenue le symbole de nos responsabilitÃĐs... La survie de Venise est un dÃĐfi total et inÃĐluctable à la capacitÃĐ de dÃĐcision de notre siÃĻcle... " Or la situation actuelle de Venise s'est encore aggravÃĐe depuis le temps, il y a vingt ans de cela, oÃđ Chastel ÃĐcrivait ces lignes et oÃđ la ville comptait encore 110 000 habitants. En 1972, au moment oÃđ le monde entier s'engageait dans la " bataille pour Venise ", on inaugurait à Marghera, en pleine lagune, juste derriÃĻre, un des plus grands terminaux pÃĐtroliers d'Europe.
La pollution de la lagune a atteint des niveaux qui, l'ÃĐtÃĐ, outre les dÃĐgÃĒts qu'elle provoque sur la flore et la faune, sont dÃĐsormais insupportables pour l'homme. Pour faire entrer les tankers dans la lagune, on y a creusÃĐ le " canal du pÃĐtrole ", d'une profondeur jamais vue, qui a bouleversÃĐ les ÃĐquilibres sÃĐculairement ÃĐtablis entre la lagune et la mer et provoquÃĐ Ã Venise une plus grande frÃĐquence du phÃĐnomÃĻne de l'acqua alta, remontÃĐe pÃĐriodique du niveau de l'eau qui envahit alors la ville.
Car, en ville mÊme, les choses ne vont pas mieux. De nombreuses opÃĐrations de restauration sont en cours, mais en apparence seulement : elles ne concernent en fait, aux termes de la loi, que le ravalement desfaçades et la rÃĐfection des toits, alors que c'est en rÃĐalitÃĐ sous la surface de l'eau que se cache la vÃĐritable menace. Le sous-sol vÃĐnitien est dans un ÃĐtat dÃĐsastreux, plus trouÃĐ et caverneux qu'une meule de gruyÃĻre. Le Rio Nuovo, l'une des voies de circulation les plus importantes, est depuis plusieurs mois fermÃĐ, car ses berges et les constructions qu'y s'y trouvent s'effondrent ; et une partie de l'ÃŪle de la Giudecca est ÃĐgalement en train de s'ÃĐcrouler. Les non-VÃĐnitiens ont achetÃĐ trop de maisons qu'ils laissent inhabitÃĐes. Le tourisme est aux mains de maffias puissantes et vulgaires, qui favorisent par tous les moyens possibles la venue en ville de groupes qui n'y passent au mieux que la journÃĐe : venus pour quelques heures, ils ne voient rien, ou bien peu de chose, et n'apportent guÃĻre à Venise que des dommages supplÃĐmentaires.
Le modÃĻle de la CitÃĐ du Vatican
Ce tourisme " pendulaire ", aveugle et sourd, a entraÃŪnÃĐ la dÃĐgÃĐnÃĐrescence du commerce, que symbolisent aujourd'hui les odieuses bancarelle, ces ÃĐtals qui empestent la place Saint-Marc et oÃđ l'on vend à des touristes stupides une pacotille de plastique fabriquÃĐe à Hongkong ou à TaÃŊwan. Ce dÃĐclin du commerce entraÃŪne avec lui celui de l'artisanat vÃĐnitien, qui comptait parmi les plus raffinÃĐs du monde... et trente ÃŪles de la lagune sont dÃĐsormais à l'abandon.
Si les choses continuent de cette maniÃĻre, nous assistons à la fin de Venise. Et nous, qui l'habitons encore, sommes les derniers des VÃĐnitiens ; nous vivons dÃĐjà presque dans la clandestinitÃĐ, comme infiltrÃĐs dans une ville qui ne nous appartient plus, pas plus qu'elle n'appartient à ceux qui, dans le monde entier, sont encore en mesure de la comprendre et de l'aimer.
Braudel rÃĐsumait ainsi la situation de Venise, lors de la prÃĐsentation, le 10 novembre 1984, Ã la Fondation Giorgio Cini, du livre citÃĐ plus haut : " Venise est aujourd'hui prisonniÃĻre de l'Italie, entravÃĐe par l'Europe et enfermÃĐe par la VÃĐnÃĐtie de terre ferme ; elle est ainsi incapable de jouer le rÃīle qui est le sien, celui de capitale culturelle du monde. "
Il s'agit là d'une synthÃĻse parfaite. La consÃĐquence logique, la voici : le long de la gronda, nom donnÃĐ au littoral terrestre de la lagune, Venise doit instaurer une frontiÃĻre tout à la fois idÃĐale et physique, afin de se fermer au dÃĐveloppement de la VÃĐnÃĐtie et de l'Italie, au tourisme " pendulaire ", aux autos, au dÃĐversement des ordures qui, de la VÃĐnÃĐtie entiÃĻre, viennent polluer la lagune, au pÃĐtrole, en un mot à tout ce qui est hard. Et, à l'opposÃĐ, c'est-à -dire en se tournant du cÃītÃĐ de la mer, Venise doit s'ouvrir à nouveau à tout ce qui est soft : la culture, les idÃĐes, les arts, la recherche scientifique et technologique (Braudel prÃĐconisait la crÃĐation d'une universitÃĐ internationale), notamment dans des secteurs tels que les sciences de l'environnement et de la conservation du patrimoine culturel, domaines dont Venise pourrait devenir le laboratoire mondial.
Il existe un modÃĻle : la CitÃĐ du Vatican, qui est comme un chronomÃĻtre suisse immergÃĐ au coeur du chaos romain. Sur cet exemple, Venise pourrait redevenir RÃĐpublique sÃĐrÃĐnissime, sereine quant à elle-mÊme et à sa lagune, sous la garantie de la CommunautÃĐ europÃĐenne et des Nations unies. C'est seulement avec cette aide qu'elle pourrait entreprendre sa " refondation ", car c'est bien de cela qu'il s'agit : une entreprise extraordinaire, qui prendra au moins cinquante ans. Bien sÃŧr, il faudra repeupler Venise, mais le monde entier est plein de femmes et d'hommes qui, moralement et idÃĐalement, se sentent citoyens vÃĐnitiens... et qui partagent cette espÃĐrance ultime avec les derniers VÃĐnitiens.
Utopie ? Sans doute. Mais l'autre solution, nous la voyons dÃĐjà en action. Il s'agit de l'irrÃĐversible transformation de Venise en une ville comme les autres, c'est-à -dire en une altra cosa, une autre chose.
MECCOLI SANDRO